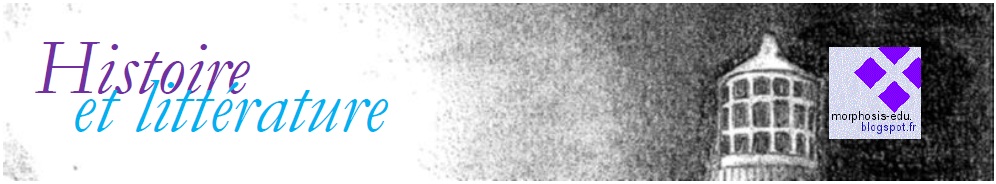La relation entre littérature et histoire n’est
jamais très claire ; de l’une nous voulons ériger une science, mieux
étayée par des auxiliaires tels que l’archéologie — la chose — ou l’héraldique
par exemple, — l’image ; de l’autre, nous dévoilant la pensée de nos
ancêtres ou d’autres, qu’à partir de l’histoire on veut croire erronée puisque
le progrès a été là où embryonnaire elle a d’abord grandi, le texte et ses mots
nous demandent l’inconcevable : perpétuer, et non pas conserver emprisonnée
sous verre, cette pensée qui toujours vient s’échouer, mais parallèlement, sur
la grève où nous pensons avancer.
L’essentiel de ce petit
chapitre sur l’histoire, loin de vouloir remédier à quelque universalité, sera
de réconforter l’obsession « positiviste » par une sensibilité
difficile à lire dans les livres d’histoire, qu’elle ne trouvera ailleurs que
dans la littérature, et, a fortiori,
dans la langue qui nous évoque les soubresauts du sens « d’histoire » :
allant d’une étude quelconque à la totalisation temporelle, ou du témoin au
juge, l’on passera nécessairement par la fable, la chronique... et le récit. C’est
dire qu’elle ne saurait seule se soutenir.